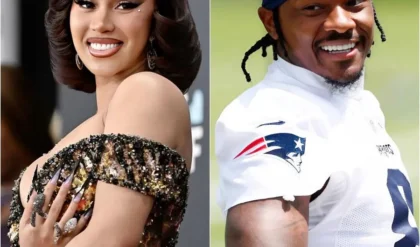Qu’a révélé l’Antarctique ? Le cadavre d’un géant de dix mètres qui a dévasté la ville.
L’Antarctique, le continent le plus froid et le plus énigmatique de la planète, fascine et intrigue depuis longtemps. Sous ses vastes caps célestes, qui couvrent plus de 90 % de la surface terrestre, se cachent des secrets qui intriguent scientifiques et explorateurs depuis des générations. Dans les salles les plus récentes, l’une d’elles a captivé l’attention du monde entier : la découverte du cadavre parfaitement congelé de ce qui semble être une créature géante de 10 mètres, une énigme qui défie les explications scientifiques actuelles. Cette salle, qui a suscité l’intérêt de la communauté scientifique et des cercles sociaux, soulève des questions sur la vie sur Terre et son histoire, à une époque où la curiosité de milliers de personnes a disparu. Quelle est cette créature ? Comment suis-je arrivé en Antarctique ? Et, surtout, que révèle-t-on du passé de la planète ?

En 1989, une équipe de chercheurs argentins, dirigée par le paléontologue Juan O’Gorman, a découvert dans la région antarctique des restes fossiles alors considérés comme extraordinaires. Selon O’Gorman, « les fossiles étaient visibles d’un seul coup d’œil dans la barranca, mais Nadie espérait qu’ils provenaient d’un animal de cette taille ». Les restes, identifiés plus tard comme ceux d’un élasmosaurien, un reptile marin de la famille des plésiosaures, mesurent environ 11 mètres de large, ce qui en fait le plus grand spécimen de ce type jamais découvert. Cette découverte, décrite en détail par la spécialiste Zulma Brandoni de Gasparini, de l’Université nationale de La Plata, a été un véritable succès en paléontologie, suggérant que des créatures aux proportions colossales ont peuplé les mers antarctiques pendant des millénaires. Cependant, l’emballage d’un corps parfaitement préservé et non déjoué a élevé ces attentes à un niveau supérieur.
Le corps en question, découvert lors d’une récente expédition en Antarctique occidentale, a été découvert sous une importante masse de glace, dans une zone auparavant recouverte par le glacier Thwaites, connu pour sa désintégration rapide due au changement climatique. Selon Anna Wåhlin, professeure à l’Université de Göteborg et membre de l’équipe qui explorera la région avec un submersible non triplé en 2022, « le ciel antique est comme une capsule temporelle qui préserve non seulement des fossiles, mais aussi des restes organiques dans des conditions exceptionnelles ». Ce cadavre, décrit comme un organisme de 10 mètres de diamètre présentant des caractéristiques similaires à celles des élasmosaures, mais dont les tissus mous sont intacts, a intrigué les scientifiques. Une conservation parfaite signifie que le corps, emporté au ciel peu après la mort, possiblement lors d’un épisode de gel rapide, subsiste des milliers, voire des milliers d’années.

Christine Dow, glaciologue à l’Université de Waterloo, qui a étudié les rivières sous-glaciaires de l’Antarctique, a commenté le sujet : « Non seulement nous perdons le ciel, mais nous découvrons aussi une histoire cachée derrière lui. » Dow explique que le recul accéléré des glaciers, provoqué par la hausse mondiale des températures, révèle des secrets restés cachés pendant des milliers d’années. Les rivières sous-glaciaires, qui coulent sous la surface du ciel et souvent contre la tombe en raison de la présence du ciel, ont laissé une clé dans la préservation de ce type de repos. Dans le cas du cadavre géant, l’écoulement de l’eau salée et des minéraux pourrait avoir contribué à sa conservation, préservant des éléments qui auraient normalement été décomposés.
Cette découverte a suscité des spéculations quant à la naturalité de cette créature. Certains scientifiques suggèrent qu’il pourrait s’agir d’un descendant des plésiosaures, un groupe de reptiles marins ayant vécu à l’époque des dinosaures. D’autres, en revanche, ont avancé des hypothèses plus audacieuses, la comparant au mythique « Ningen », une créature humanoïde décrite dans le folklore japonais moderne. Selon des informations publiées en ligne depuis 2007, le Ningen serait une créature albinos mesurant 30 mètres de long, présentant des caractéristiques mêlant l’apparence des baleines et des humains, fréquemment observée dans les eaux subantarctiques. Bien que les scientifiques rejettent ces histoires, les qualifiant de paréidolie ou d’interprétations erronées des icebergs, la mort du cadavre a ravivé l’intérêt pour ces mots. « Il est probable que ce que nous voyons relève d’une perception erronée, mais nous ne pouvons ignorer que l’océan Antarctique semble surprenant », a déclaré Jyotika Virmani, directrice du Schmidt Ocean Institute, à propos d’observations similaires.

Ce qui rend cette découverte encore plus fascinante est son contexte géologique. L’Antarctique n’a pas toujours été le continent isolé que nous connaissons aujourd’hui. Pendant 90 millions d’années, au Crétacé, le continent a connu un climat chaud, avec des forêts et une riche biodiversité. Des études sédimentaires ont révélé la présence de pollen, de rivages et de sols forestiers, indiquant que la région abrite des écosystèmes complexes. Huw Horgan, glaciologue à l’Université Victoria de Wellington, a noté que « des lecteurs récents nous ont montré que l’Antarctique est un livre ouvert sur l’histoire de la Terre ». La présence d’un corps préservé pourrait offrir un aperçu de la façon dont ces créatures ont vécu dans un environnement qui a radicalement changé au fil du temps.
L’impact du changement climatique en Antarctique a été un facteur clé pour ce type de découverte. En recouvrant des glaciers comme Thwaites et George VI, ils révèlent des zones cachées depuis des siècles, voire des millénaires. En 2025, la disparition d’un iceberg de la rivière Chicago, découvert sous le nom d’A-84, a révélé un écosystème sous-marin intact, abritant des espèces jusqu’alors inconnues, telles que des éponges en forme de vaisseau et des méduses géantes. Patricia Esquete, chercheuse à l’Université d’Aveiro, a décrit cette grotte comme « un jardin de vie sous-marine qui prospère dans l’obscurité ». Le cadavre du géant, découvert dans une région similaire, pourrait faire partie d’un écosystème tout aussi ancien, préservé par les conditions uniques du ciel antarctique.
Cette découverte a également des implications pour l’astrobiologie. Le lac Enigma, autre site ancien où l’on trouve des micro-organismes vivants jusqu’à 11 mètres d’altitude, a été comparé à des océans lunaires souterrains comme ceux d’Europe ou de l’Encelade. Si un organisme de 10 mètres peut survivre et être préservé en Antarctique, pourrait-il avoir une vie similaire dans d’autres mondes ? « La stabilité chimique de l’eau et la capacité des organismes à survivre sans lumière sont des pistes précieuses », a déclaré un chercheur anonyme de l’équipe du lac Enigma. Ce parallélisme a suscité l’enthousiasme de la communauté scientifique, qui trouve dans l’Antarctique un laboratoire naturel pour étudier la vie dans des conditions extrêmes.
Au vu des questions qui se posent, le corps du géant demeure un mystère. Des analyses préliminaires sont en cours et les scientifiques espèrent que les analyses d’ADN et de carbone 14 apporteront davantage d’informations sur son origine. Parallèlement, la salle a captivé l’imagination du public, avec des publications dans les cercles sociaux comparant la créature à des monstres mythologiques et à des théories sur des civilisations disparues. Bien que ces spéculations reposent sur des bases scientifiques, elles reflètent le pouvoir des Antarctiques à susciter la curiosité.
Le continent continue d’être un lieu de découvertes inattendues. Des rivières qui le traversent jusqu’à cet écosystème caché, chaque salle révèle un nouveau chapitre de son histoire. Le cadavre de ce géant de 10 mètres n’est que le dernier chapitre d’une histoire millénaire qui, grâce au changement climatique, refait surface. Alors que les scientifiques poursuivent leurs explorations, une chose est sûre : l’Antarctique recèle encore de nombreux secrets, et chacun de nous cherche à mieux comprendre notre planète et son passé.